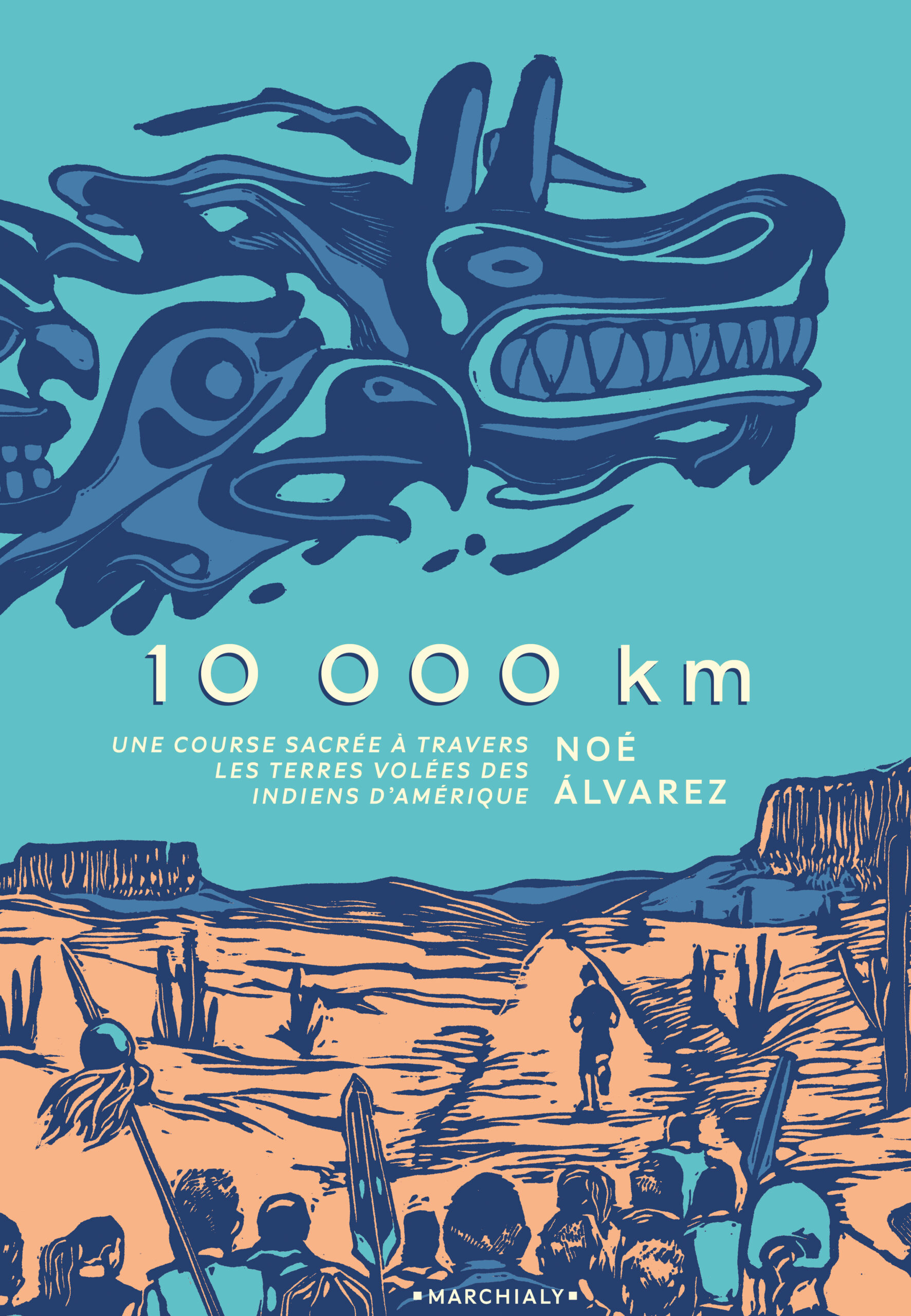Nous courons libres
Noé a à peine rejoint la course qu’il connaît ses premières difficultés. Il va devoir tenir physiquement sur la longueur et surtout gagner sa place dans le groupe.
« Ok, prochain coureur », annonce Andrec en freinant, ce qui en réveille certains.
Tout le monde sort pour s’étirer un peu. Le grand van est garé à côté de nous, Trigger est au volant.
« Noé, tu repars d’ici », me dit Andrec.
Ce sera mon deuxième tronçon de la journée. Encore 15 km.
Les coureurs s’entassent à l’arrière du van avec Andrec. Mes muscles sont raides. J’ai les jambes qui tremblent. Je cache ma douleur. Mes chaussures ne m’aident pas beaucoup. J’essaie de m’étirer, mais dès que j’aperçois le regard de Trigger posé sur moi, je m’élance sur le chemin qui s’enfonce dans la forêt épaisse, comme tout à l’heure. Tout est si vert autour de nous. Je ne veux pas qu’il pense que je suis faible. Pendant un moment, je cours devant les deux vans qui doivent manœuvrer entre les nids-de-poule creusés par la pluie et, désormais, par mes pieds. Je sens le poids de ce public, les regards braqués sur moi, se demandant qui est ce nouveau, me jaugeant moi, mon mental, ma condition physique, doutant peut-être que j’aie ce qu’il faut pour courir pendant cinq mois et atteindre la ligne d’arrivée au canal de Panama. Je ressens déjà la douleur du coureur de fond. Le minivan gris est le premier à accélérer et me contourne soigneusement par la gauche pour aller déposer les coureurs à intervalles réguliers, tandis que Trigger doit se rendre à l’arrivée de l’étape pour récupérer les autres. J’essaie de ne pas montrer que mes crampes et mes ampoules me font souffrir.
« Allez bonhomme. Mexica, tiawi ! », crie Tlaloc par la fenêtre quand le van gris me dépasse. « Allez les Mexicains ! » en nahuatl.
Le van gris disparaît, me laissant avec Trigger qui m’observe depuis la camionnette. Il roule doucement à côté de moi, une main sur le volant, l’autre sous son menton. Il me jette un regard noir.
« Tout le monde fait le taff ici. Compris ? »
Je hoche la tête. De son point de vue, je suis un poids mort. Un petit nouveau qu’il faut remettre à sa place.
« C’est pas un jeu.
— Compris. Je suis là pour faire le boulot. Sans rire. J’ai envie d’apprendre », dis-je, entre deux inspirations. Avec un rictus, il appuie sur l’accélérateur, ses roues continuant de déchiqueter la terre, puis il disparaît au loin sur le chemin qui serpente entre les pins. Je comprends maintenant que Trigger encadre les PDJ, du moins officieusement. Il a une attitude de leader ou peut-être de brute.
Je donne des coups de poing dans le vide et je me bats la poitrine comme si j’étais au bord de la Naches – je réveille ma chair. Le vent fait claquer les branches autour de moi, pareil à un fouet destiné à me revigorer. Je profite d’être seul pour crier le plus fort possible, pour faire sortir toute la laideur au fond de moi. Je crie pour rendre mon discours physique, pour donner du muscle à mes mots et pour trouver la force nécessaire de dire les choses que je n’ai jamais réussi à formuler.
Je cours pour suivre du mieux possible le chemin de ceux qui m’ont précédé : les migrants qui ont connu la souffrance et les privations. Je cours pour retrouver des fragments de mes parents disséminés dans la terre, des artefacts, leurs histoires d’espoir et de désespoir. En me confrontant à tout cela, j’essaie de mettre enfin un terme à toute la souffrance qui me hante depuis mon enfance. Je veux apprendre à embrasser mon passé, l’endroit d’où je viens, et à m’aimer à nouveau.
Dans cette forêt, je sens que je suis enfin sur le chemin de ma libération.