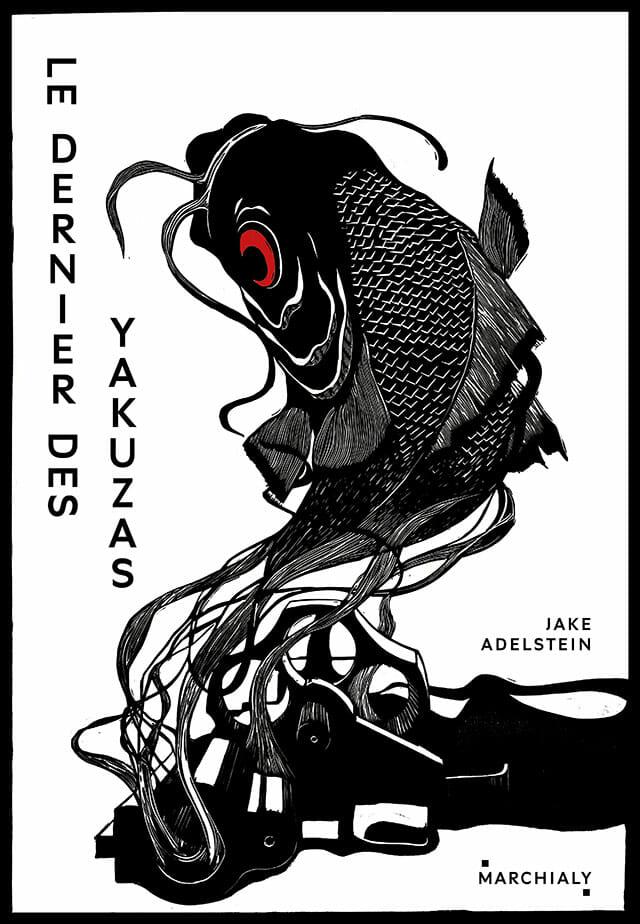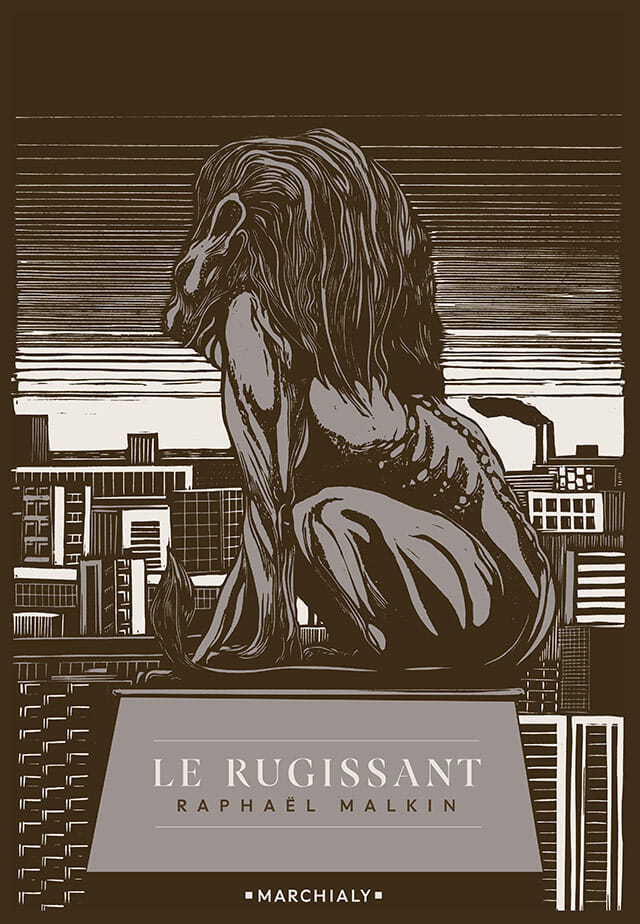Avertissement
Karim Madani nous raconte la genèse de Jewish gangsta.
New York, 1999. Un vent glacial venu du Michigan et de la région des Grands Lacs balaie la plus grande circonscription de la ville. Je me réchauffe dans des coffee shops et surtout chez des petits disquaires. Je suis un jeune chroniqueur musical et je pige régulièrement pour les premiers magazines de « cultures urbaines » — cette expression est atroce, mais je la garde par commodité terminologique —, comme RER ou L’Affiche, des publications pionnières. À l’époque, j’écoute encore des disques sur des platines et je passe des heures à digger — fouiner — pour trouver des nouveautés, essentiellement des Maxi 45 tours. Je passe aussi des heures dans des cabines téléphoniques à attendre que des artistes me rappellent. Les smartphones n’existent pas encore et je poireaute devant les cabines, au milieu des dealers et des travailleurs latinos qui appellent au pays. Je m’occupe de la rubrique Underground et je suis toujours à la recherche d’un jeune artiste émergent, un rookie, comme on dit aux États-Unis. D’ailleurs, j’en profite pour vous avertir en passant que j’utilise beaucoup de mots américains dans ce livre, non pas pour me donner un genre ou une posture à la mords-moi-le-noeud, mais pour coller le plus à la musique et au flow des gens que j’ai rencontrés à cette époque. De 1998 à 2010, j’ai effectué une série de voyages de presse et de voyages personnels à New York et ce livre est le fruit de cette expérience.
Mais revenons à cette journée glaciale de février, quand je découvre le Maxi Legacy, d’un groupe qui se fait appeler Non Phixion. J’achète le disque et l’écoute. Ce qui me frappe tout d’abord, c’est l’utilisation du mot goon. Qui sont ces goons ? Je me rends compte qu’on est bien loin des clichés du gangsta rap noir américain. Les types ont des flows atypiques et des thèmes qui vont un peu plus loin que le classique : j’ai/le/plus/ gros/flingue/la/plus/grosse/queue/la/plus/grosse/chaîne/la/plus/grosse/caisse, enfin vous voyez à peu près à quoi je fais allusion. Je décide d’en savoir plus sur ce groupe. Non Phixion. Le macaron n’indique que le nom du label. J’interroge les disquaires qui me renvoient à d’autres disquaires qui me connectent enfin à un type qui connaît bien ces gars, et pour cause, c’est leur DJ et il s’appelle Eclipse. Un grand Blanc dégingandé qui bosse chez un disquaire mythique de New York, Fat Beats Records, qui est aussi un label underground à l’identité musicale pointue et plébiscitée par les puristes. Eclipse passe des coups de fil. Entretemps, je continue à faire des interviews dans des bagnoles, sur des terrasses de HLM en forme de Y, dans des cages d’escalier, dans des Burger King, de jour comme de nuit. Avec mon dictaphone à cassettes Sony de la taille d’une machine à laver, j’enregistre les récits épiques d’anciens repris de justice devenus poètes du bitume. Et puis, un beau jour, Eclipse m’appelle à la cabine téléphonique de Williamsburg (c’était avant que les hipsters ne débarquent avec leurs thés bios à 10 dollars le gobelet et ne forcent les dealers de marijuana à déménager un peu plus au nord de Brooklyn) et me dit que le groupe Non Phixion serait très honoré de me rencontrer. C’est la première interview qu’ils font avec un journaliste européen et ils m’invitent à écouter leur maquette de The Future Is Now, leur premier album, dans un HLM de Brooklyn.
Je rencontre des êtres humains incroyables. Des crapules, des dealers, des braqueurs, des toxicomanes, des repris de justice. Sur la plupart d’entre eux plane l’épée de Damoclès d’une justice à deux vitesses. Le groupe Non Phixion me permet de mettre un pied dans cet underworld. Ils sont d’abord étonnés qu’un Parisien ait traversé l’Atlantique pour venir poser des questions à un groupe d’anciens délinquants juifs du ghetto et n’en reviennent pas lorsque je leur cite Lester Bangs, Schoolly D, Big Daddy Kane, Bret Easton Ellis et Paul Baloff dans la même phrase. C’est bon, les goons m’adoubaient.
Toute la clique est complètement barrée. Le leader, Ill Bill, m’a connecté à Necro, son petit frère, un rappeur, producteur et réalisateur. Ces deux-là m’ont raconté leur histoire, qui se trouve dans le livre que vous avez entre les mains. Dans les années 1930, c’était la Yiddish Connection et les gangsters juifs qui tenaient Brooklyn d’une main de fer. Cinquante ans plus tard, on retrouve une grappe de jeunes durs se réclamant de cet héritage, coincés dans des HLM et luttant pour survivre à Gangland. Leurs parents avaient fui l’URSS ou avaient été expulsés d’Israël dans les années 1970. J’ai été frappé par leurs récits. Bigger than life. Un peu plus tard, mes connexions dans l’underground se sont multipliées et j’ai rencontré Big Vic-Lo, de la bande des voleurs réunis et associés qui pillait les magasins de grandes enseignes à New York à la fin des années 1980. Puis des types louches et patibulaires m’ont mis sur les traces d’un jeune Juif en fauteuil roulant qui se faisait appeler Maya Lansky dans la rue et qui me confia son histoire accidentée, jamais racontée jusque-là. Et plus tard encore, en traînant à LeFrak City dans le Queens, j’ai entendu parler d’une certaine J.J., la première Juive du Queens à avoir fondé un gang de filles à Corona. 1989. C’est la genèse. Le début de trois histoires, trois destins, trois trajectoires aussi brutales que celle d’un projectile de .22.
Certains noms ont été changés pour protéger les coupables, même si je crois qu’il y a prescription, d’autres parce que les gens ont changé de vie, ont fondé une famille et ne veulent plus être associés à ce style de vie auquel un rappeur de la 186th Street à Harlem, Big L, donnait le nom de « Lifestylez ov da Poor and Dangerous », parodiant le titre de la série TV des années 1980, Lifestyles of the Rich and Famous, série encourageant à la poursuite du bonheur entrepreneurial.
Il sera souvent question dans ce livre de flingues, de dope et de transactions illicites, de flics et de gangs, de couleurs et de territoires. J’ai essayé de rester le plus fidèle possible aux propos de mes interlocuteurs, même si plusieurs versions d’une même histoire pouvaient parfois circuler d’un entretien à l’autre. Et cela pour une bonne raison. Dans ce monde-là, on cultive les zones d’ombre quand il le faut. On exagère un fait parce que la rue vous demande des comptes ou alors on minimise la portée d’un acte ou d’un délit pour des raisons très diverses. Les types dont vous lirez les histoires dans ce livre ont vraiment existé. Ils ont côtoyé ce que la société produit de pire : la prison, l’addiction aux drogues, les armes, les familles dysfonctionnelles, et toute la violence que cela comprend, et ce depuis leur plus jeune âge. Leur histoire commune est un voyage dans le New York de la fin des années 1980 jusqu’au milieu des années 1990, où le taux d’homicide avait grimpé en flèche, quand Brooklyn n’était pas encore la terre promise des bobos et des hipsters. Le langage est très cru et j’ai essayé de garder un aspect ebonic et broken english, la langue vernaculaire du ghetto.
Au programme : du sang, de la sueur et des rimes. Les bas-fonds d’une mégalopole schizophrène. Je vous ramène à une époque où on ne vendait pas encore de bonbons M&M’s sur la 42nd, mais du crack et de la cocaïne. J’ai toujours éprouvé de la curiosité pour les gens qui prennent le chemin de la criminalité, celui de l’illégalité. Surtout dans les grandes métropoles américaines. Je ne suis pas fasciné par le crime, mais j’ai toujours voulu savoir comment tout cela fonctionnait.
À l’échelle humaine, d’un quartier. Comment la musique et la drogue faisaient bon ménage. J’ai essayé de raconter la vie de ces types sans complaisance ni apologie de la dope ou des armes. Mais à aucun moment je ne porte de jugement sur mes interlocuteurs. Des juges, ils en ont déjà vu un paquet au cours de leur vie.
J’ai simplement voulu raconter la face A et la face B de New York. À une époque où beaucoup d’enfants de cette ville choisissaient la voie de l’anarchie. L’histoire de ces jeunes « jewish gangsta » n’avait encore jamais été racontée. Il était temps de leur rendre justice. Une justice poétique.