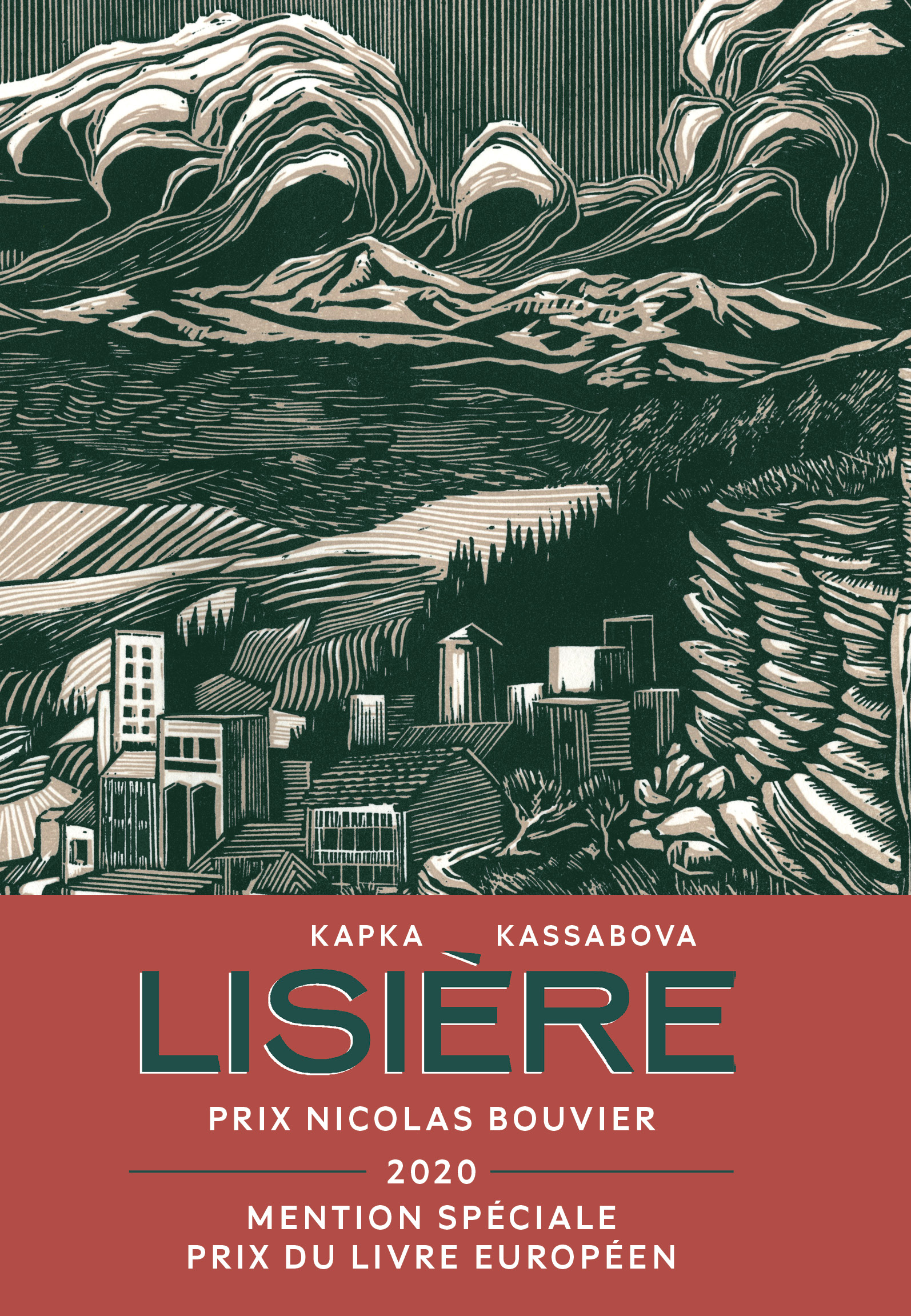Aux sources
Kapka Kassabova est poétesse, romancière, essayiste. Avec Lisière et L’Écho du lac, elle expérimente une nouvelle forme d’écriture et de narration et joue avec plusieurs registres dans un seul but : décrire au plus juste les régions fragmentées qu’elle parcourt.
Combien de fois ai-je vu apparaître, au détour d’un chemin comme celui-ci ou d’une route cahoteuse, une fontaine d’eau potable. Une cheshma. Ce mot turc, tout le monde à travers les Balkans le comprend, et la cheshma est le symbole de ces contrées. À quoi sait-on qu’on a pénétré dans les Balkans ? À l’eau qui gargouille sans qu’on la voie. On marche jusqu’à la trouver.
Au col de Gjavato, à cheval sur le pic Pelister, juste au nord et en surplomb du lac Prespa, se trouve une cheshma insolite : elle bifurque naturellement. Une partie de son eau s’écoule vers l’est et la mer Égée, tandis que le reste suit son cours jusqu’à l’Adriatique. Difficile, toutefois, de constater la part naturelle du phénomène puisqu’on a bétonné la source pour la scinder en deux jets orientés dans des directions opposées, telles les deux faces de Janus. Dispositif reflétant le morcellement du lac Prespa en trois, et les frontières nationales invisibles déployées dans ses eaux d’argent.
J’ai rempli ma gourde à la cheshma. Le col de Gjavato reliait autrefois la via Egnatia à la route de l’Épire, plus au sud, et apparaissait sur les cartes du monde gréco-romain comme finis Macedoniae et Epiri, l’ultime frontière de la Macédoine et de l’Épire. Assise sous un abri défoncé où ne s’arrêtait aucun bus, une vieille femme tenant des herbes dans un sac m’a appris qu’elle avait marché depuis le village de Gjavato, à 5 kilomètres de là, pour retrouver un ami qui n’était pas venu. Bien qu’édentée, elle portait du rouge à lèvres et une jolie robe.
Le vent chaud entraînait la voiture avec lui, sur les traces fantomatiques de détachements prétoriens, d’armées médiévales, de croisés en cotte de mailles, de caravanes aux cavaliers enturbannés et aux femmes voilées ; des bergers aroumains drapés dans des yamurluks(des capes) de feutre, dirigeant les immenses troupeaux qui nourrissaient la péninsule, des missionnaires ascètes venus de Syrie chaussés de sandales taillées à la main qui leur causaient des ampoules aux pieds, des paysans mutiques à dos de mules affairés à cueillir des herbes, des fusils cachés sous des couvertures en prévision du prochain soulèvement, des messagers transportant des lettres cachetées, des collecteurs d’impôts, des komitas, des facteurs et des hommes pourchassés par des vendettas comme on l’est par des furies. Et bien sûr, des derviches soufis, des bâtons sculptés entre les mains, et, s’élevant du fond de leurs entrailles, le chant extatiquela elaha ella’llah. Et si vous fouliez les prairies alpines, chaque vue à couper le souffle supplantée par la suivante, comme les pages d’un livre de secrets, vous chanteriez, vous aussi, comme moi.
Les lieux où sont ancrés Lisière et L’Écho du lac en ont fait des polyphonies polyglottes. Le sud-est et le sud-ouest des Balkans, respectivement, contiennent des multitudes. Comme le disait l’écrivain plurilingue Elias Canetti : « Rien de ce que je vivrai plus tard qui ne se fût déjà produit, sous une forme ou sous une autre, [ici][1]. » De même, dans le poème de Walt Whitman –« Suis-je en contradiction avec moi-même ? Alors c’est parfait, je me contredis (je suis vaste, je contiens des multitudes)[2] » –il arrive que les multitudes se contredisent. Pareil pour les tribus voisines, les mères et les filles, les femmes et les hommes. Ici, le personnel et le politique, l’humain et le non-humain, le présent et le passé se faisaient jour sous la forme d’une toile inextricable –et ces thématiques universelles sourdaient de la terre elle-même. De la même façon que j’avais senti la présence du lac Ohrid chez ma grand-mère. Elle portait le lac en elle, tout comme ma mère, puis moi.
Cette idée, Agnès Varda l’a très bien exprimée par les mots suivants : « Si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages[3]. »
Mon instinct me poussait vers les paysages qui résonnaient du carillon de la nature et de la culture, les deux. À une époque où la monoculture –à la fois dans la sphère agricole et dans l’arène politique –menace de nous diminuer, une force irrésistible m’incitait à explorer des géographies qui se révélaient des écosystèmes à part entière, humains et non humains.
Lisière et L’Écho du lac ont tout simplement adopté la forme de ces écosystèmes. Des voix, des expériences sensorielles, des événements, des rêves et des échos imprègnent le récit à la manière de la sève dans un arbre. Un auteur français, un jésuite dont le nom m’échappe, a un jour affirmé que les lieux hantés étaient les seuls où les humains puissent vivre. Les lieux hantés sont les seuls sur lesquels je puisse écrire. Ce sont les lacs, les montagnes transfrontalières, les psychés des peuplesmeurtrispar les frontières et les mensonges (ce qui revient au même), mais recelant aussi une kyrielle de secrets pas encore recueillis susceptibles de nous redonner foi en l’humanité, telle une source dont le murmure nous parvient, quelque part dans les bois, puis guide nos pas jusqu’à elle.
[1] Elias Canetti,Histoire d’une jeunesse. La langue sauvée,I,Roustchouk (1905-1911), , traduit de l’allemand par Bernard Kreiss, Albin Michel, 1980.
[2] Walt Whitman,Feuilles d’herbe, « Chant de moi-même », section 51, traduit de l’anglais par Léon Bazalgette, Mercure de France, 1926, p. 126.
[3] Agnès Varda, Les Plages (documentaire), 2008.