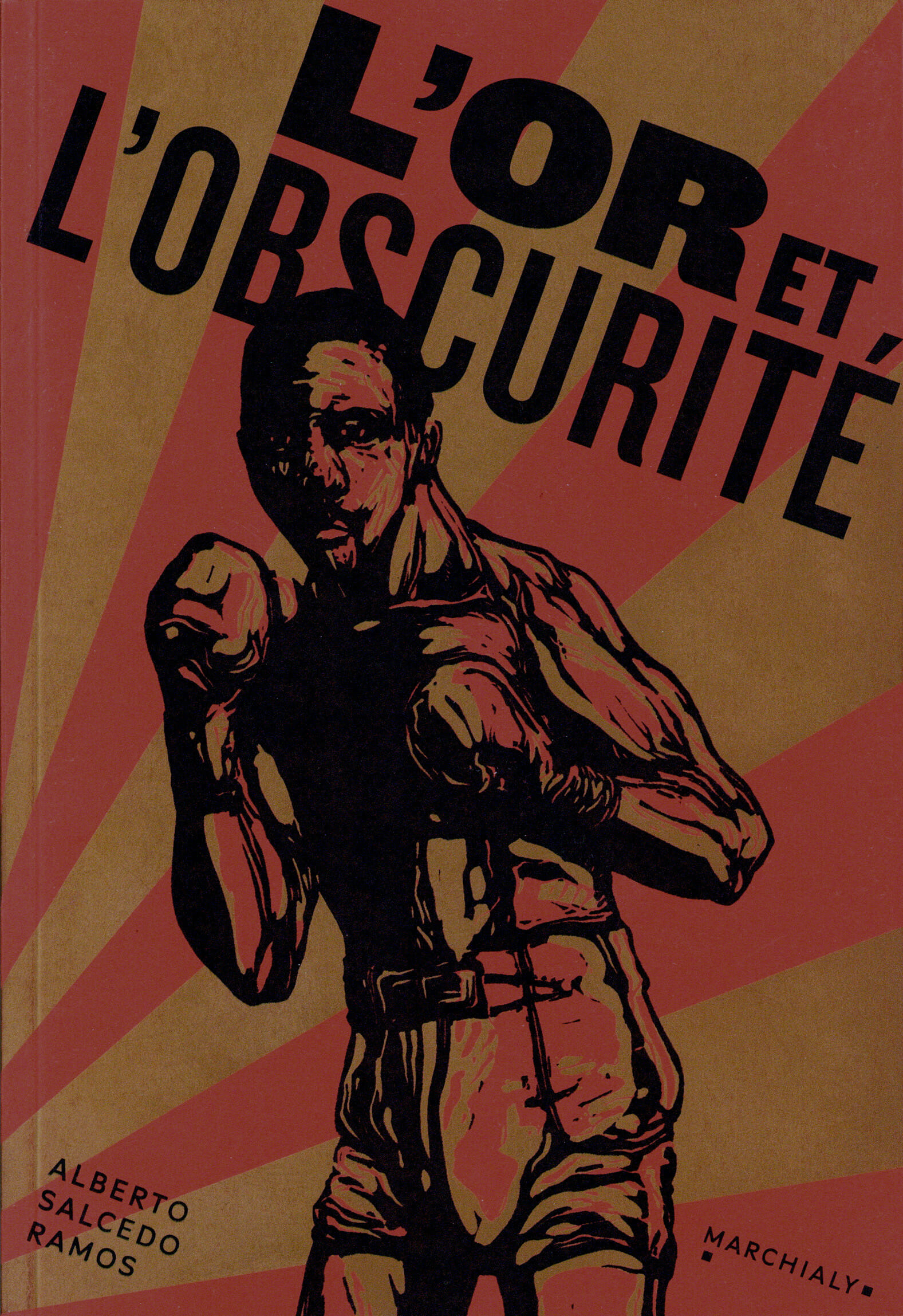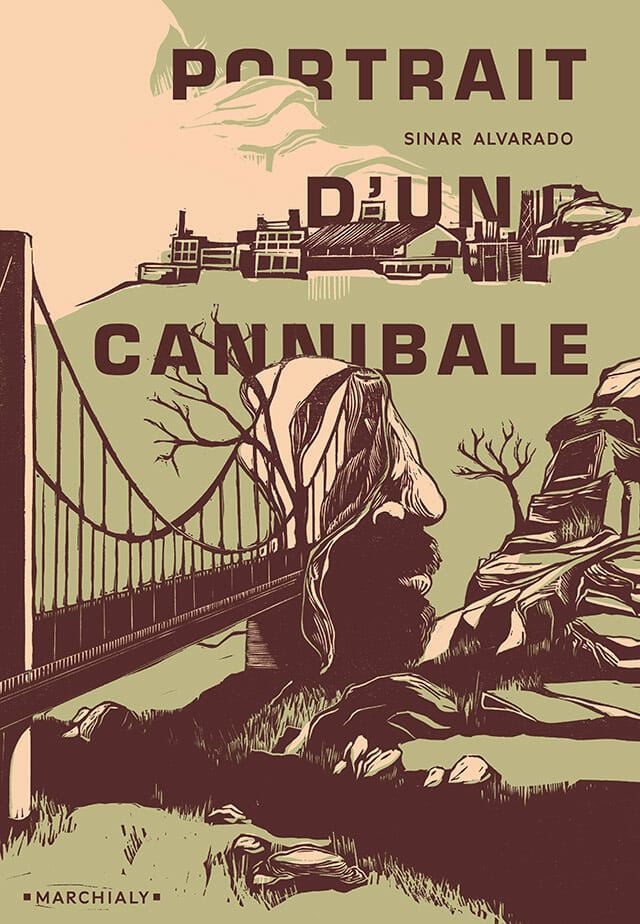D’une vocation à l’autre
De la révolution cubaine à la révolution sandiniste il n’y avait qu’un pas. Alma Guillermoprieto revient pour nous sur la genèse de son livre, de sa carrière de journaliste et d’écrivain.
Pourquoi avoir écrit ce livre près de trente ans après les faits ?
Ces six mois à Cuba ont changé ma vie et pourtant, avec le temps, j’ai fini par oublier que j’avais séjourné à La Havane en 1970, à l’âge de 20 ans. C’est plus tard, en 1998, quand Fidel [Castro] a invité le pape Jean-Paul II à venir lui rendre visite que je me suis souvenue.
Lorsque j’ai eu vent de cette invitation, j’ai imaginé Fidel – Fidel, le bouffeur de curés invétéré ! – agenouillé devant un autel sur la place de la Révolution, recevant la bénédiction du pape, et il était impossible pour moi de ne pas voir ça. Bob Silvers, de la New York Reviews of Books, m’a immédiatement soutenue et je suis partie.
J’étais de retour à La Havane et, alors que je me rendais à pied place de la Révolution, j’ai été assaillie par les souvenirs, les odeurs, l’air moite et marin sur ma peau, la tristesse, l’élocution syncopée des Cubains, leur exaspération devant la pénurie d’eau, de papier hygiénique, de nourriture, l’absence du moindre réconfort pour les Cubains, pour moi-même.
Je suis allée voir l’école de danse située dans le centre architectural de l’ENA – Écoles nationales des Arts –, où j’avais donné des cours bien des années avant, et j’ai eu le sentiment de n’être plus que le fantôme de moi-même. De retour à la maison, les fantômes se sont multipliés. La voix de mes amis d’autrefois surgissaient sans cesse, les vagues de la digue de La Havane venaient se briser à mes pieds. Des pleurs dans ma gorge cherchaient à sortir. Et j’ai commencé à écrire.
Comment avez-vous commencé votre carrière de reporter ?
En répondant à la question précédente, je m’aperçois que tous les événements décisifs de ma vie n’ont pas été des accidents, comme je l’ai toujours dit, mais plutôt les conséquences imprévisibles de décisions irrationnelles et de mon profond désir de voir, de témoigner.
En août 1978, à Managua, au Nicaragua, un groupe de guérilleros membres du Front sandiniste de libération nationale a pris d’assaut ce qu’ils appelaient le chanchero, la porcherie – à savoir, le Congrès national –, du dictateur Anastasio Somoza. Après de longues négociations, Somoza a accepté d’échanger les députés contre des prisonniers politiques. Les guérilleros et les détenus émaciés récemment libérés sont partis à bord d’un bus scolaire jaune en direction de l’aéroport avant de s’exiler à Cuba, et, à l’étonnement de tous, à commencer par celui des guérilleros eux-mêmes, la ville entière est descendue dans les rues pour leur dire au revoir.
Il y a des moments – comme le 11 septembre 2001 – où tout le monde comprend en une fraction de seconde que plus rien ne sera jamais pareil. En voyant les images à la télé de ces guérilleros et des Nicaraguayens heureux, j’ai senti qu’il fallait que j’aille là-bas. Jamais je n’avais voulu être reporter, bien que mon ami John Rettie – ami de ma mère, en fait – m’ait répété pendant des années que j’étais faite pour ce métier. Il était le cofondateur et le directeur d’un média basé à Londres, Latin American Newsletters. Je suis de nature timide, et je l’étais encore plus à cette époque. Je n’ai pourtant pas hésité à décrocher mon téléphone et à mentir en disant que je partais pour Managua car plusieurs médias mexicains m’avaient commandé des articles. Tu as déjà ton visa ? m’a demandé John. Je n’avais pas pensé à cet obstacle. Qui prend tes frais en charge ? Ça non plus, je n’y avais pas pensé. Si tu as le temps de nous envoyer quelques brèves au milieu de tout ce que tu as à faire, on couvrira tes frais avec plaisir.
Quelques jours plus tard, visa en poche, j’atterrissais à Managua, désolation de poussière et de ruines sans fin à la suite du tremblement de terre de 1972. Sans avoir la moindre idée d’où je devais aller, je dis au chauffeur de taxi de me conduire à un hôtel où il y aurait de nombreux journalistes. J’arrivai à l’Intercontinental, où je fis la connaissance d’un ami de John, Alan Riding. Il me présenta la photographe Susan Meiselas – nous sommes inséparables depuis ce jour – qui m’offrit de partager sa chambre. Le lendemain matin, le téléphone sonna à 5 h 30. Je m’appelle Richard Gott, je suis responsable du service international du Guardian, nous ne parvenons pas à entrer en contact avec notre pigiste en Amérique centrale, et mon ami John Rettie me dit que vous êtes une reporter formidable. Cela vous serait-il possible de m’envoyer une brève pour demain ?
C’est ainsi que tout a commencé.