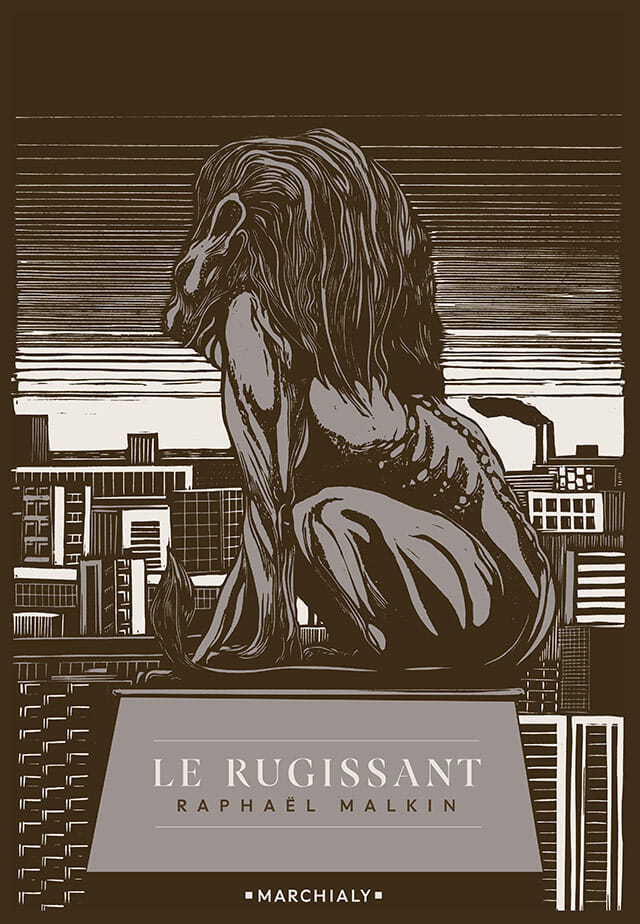Vivre un revival
Karim Madani écrit depuis près de trente ans. Il a commencé sa carrière au débit des années 1990 dans la presse rap et hip hop naissante. En qualité de vétéran, il revient sur cette époque pionnière et la télescope avec l’époque contemporaine. Mode confession on.
Ces cinq dernières années, j’ai été à la fois perplexe et amusé par le revival des années 1990 au cinéma, dans la pub, dans la mode, dans la musique et en littérature. Jamais les années 1990 n’auront été aussi documentées. D’excellents livres ont été publiés, dans ma propre maison comme dans d’autres, sur, je n’aime pas le mot, les cultures urbaines ;ce que je préfère appeler lastreet culture ou alors la mythologie urbaine. Quand je parle de mythologie, je veux dire que le vrai 50 Cent (le gangster, Kelvin Darnell Martin) a inspiré l’autre 50 Cent (Curtis James Jackson, vrai rappeur aspirant gangster), le vrai Rick Ross (Ricky Donnell Ross, trafiquant de coke indirectement lié à la CIA à l’époque des Contras et du reaganomics) a inspiré l’autre Rick Ross (William Leonard Roberts, ex-gardien de prison, aspirant gangster et authentique rappeur). Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Vous trouverez les mêmes personnages dans le graffiti, des anecdotes incroyables avec, à la fin, une question cruciale à la Richard Matheson : Suis-je une légende ?
Je ne l’affiche pas sur un tee-shirt mais je suis un pur kid des eighties. Et je ne l’affiche pas non plus en grosses lettres mais j’ai été immergé en temps réel dans la culture hip hop des années 1990. Mon âge canonique me permet d’exhiber quelques disques achetés en 1993 et 1994 et parfois dédicacés. Les livres sur la culture hip hop écrits par des français étaient quasiment inexistants. Il faudra attendre la fin des années 1990 pour trouver quelques œuvres éparses, sur la métrique ou la phraséologie, souvent écrites dans une langue coagulée d’universitaires ou de doctorants en sociologie. Ceux qui avaient des histoires incroyables à raconter, parce qu’ils les avaient vécues,considéraient la littérature (et tout objet répondant au nom de « livre ») comme une activité bourgeoise issue de la culture dominante. Vous comprenez, ces types massacraient des rames de métro à coups de bombe et dansaient sur des cartons posés à même le bitume, la simple idée d’ouvrir un livre pouvait être paralysante. La faute à un système scolaire qui vous écrase la gueule à coup de gros pavés écrits par des auteurs morts et sacralisés. À Paris, mes amis issus du même milieu social que moi, c’est-à-dire des fils d’ouvriers, lisaient peu ou pas du tout. N’oublions pas que les types qui ont importé le hip hop à Paris étaient majoritairement issue d’une bourgeoisie parisienne lettrée et éclairée. Ils pouvaient s’offrir un billet pour New York, qui dans les années 1980 coûtaient un rein. Ces types ont fondé des magazines comme Actuel ; d’autres fils de bonne famille comme les Cassel (Vincent et Matthias alias Rockin’ Squat) ont aussi ramené un bout de Bronx à Paris ; sans oublier Philippe Lehman, l’héritier de la banque du même nom, qui taggait son nom partout dans Paname : Bando. Mais tous les autres, les rappeurs et les graffeurs issus du lumpen prolétariat et de l’immigration, eux n’auraient imaginé écrire leurs histoires.
J’ai intégré accidentellement la rédaction d’un des premiers magazines de hip hop français, RER.Les journalistes que j’ai croisés étaient presque tous passés par une école. Peu d’autodidactes dans ce milieu. La pratique de l’écriture, qu’elle fût journalistique ou littéraire, était quelque chose d’infiniment élitistedans les années 1990 et il a fallu attendre la fin de la décennie pour lire les premières œuvres dites de « littérature urbaine ». Alors que les écrivains rock proliféraient. Les Nick Kent, les Nick Cohn, les Lester Bangs, tous ces rock criticsqui s’essayaient à littérature, avec une aisance et un talent incroyable. Le hip hop manquait encore cruellement de plumes. Le mot littérature sonnait pompeux à l’époque dans mon milieu social. Rares sont ceux qui le prononçaient d’ailleurs. Les types rappaient mais n’écrivaient pas. La notion d’écriture est apparue à la fin des années 1990. Mon livre Jewish Gangstaest sorti presque vingt-quatre ans après que j’ai rencontré cette clique de barlous brooklynites. Jamais à l’époque je n’aurais eu l’idée d’en faire un livre. Le monde littéraire n’était pas prêt pour ce genre de bouquin, je crois. Le milieu nourrissait beaucoup de clichés et de fantasmes sur la street culture. Et avait peur aussi. Quels éditeurs auraient été assez dingues pour me suivre dans cette affaire ?